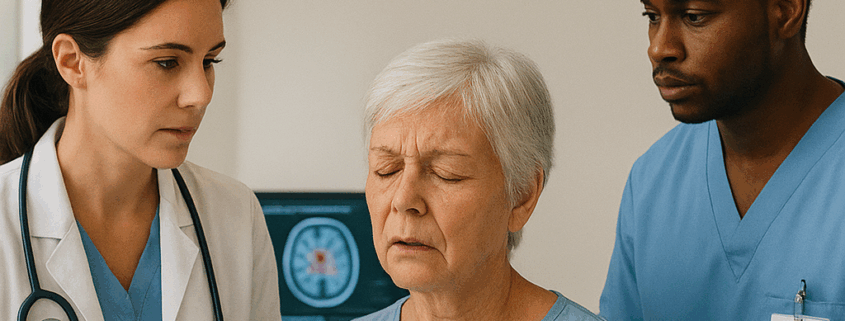Prise en charge des AVC : la France ne tire pas pleinement parti des progrès médicaux
Alors que d’immenses progrès médicaux ont été réalisés dans la prise en charge de l’AVC, une grande partie des patients en profitent trop tard, voire pas du tout, déplorent à la fois spécialistes, Haute Autorité de santé et Cour des comptes.
29/10/2025 Par Louise Claereboudt - Cardiologie Neurologie
“On a fait tellement de progrès scientifiques qu’il faut maintenant se concentrer sur l’offre de soins et la mise en œuvre de ces magnifiques découvertes”, résume à l’AFP la neurologue Charlotte Cordonnier, présidente de la Société française neuro-vasculaire (SFNV), à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux (AVC), mercredi 29 octobre.
Alors que les AVC tuent plus de 30 000 Français chaque année – représentant la première cause de mortalité féminine et la seconde masculine – et engendrent, pour les survivants, d’importantes séquelles, la France n’est pas à la hauteur de cet enjeu de santé publique, selon les spécialistes.
De nombreuses victimes d’AVC sont mal prises en charge, que ce soit lors du déclenchement de leurs symptômes ou dans leur suivi à plus long terme.
Pourtant, depuis la fin des années 1990, les innovations médicales se sont multipliées pour finalement révolutionner le traitement des AVC, du moins pour les AVC ischémiques qui représentent environ 80 % des AVC.
La thrombolyse, “validée sur le plan scientifique dès 1995 et qui s’est développée en France dès le début des années 2000”, et la thrombectomie, qui s’est développée à partir de 2015, ont “bouleversé la neurologie vasculaire, qui est passée ainsi d’une relative impuissance face aux AVC à l’exigence d’intervenir en urgence, de jour comme de nuit”, souligne la Cour des comptes dans un rapport publié ce mercredi.
Autre avancée majeure : la création de services spécialisés dans le traitement des AVC au stade aigu, les unités neuro-vasculaires (UNV).
L’expérience montre que ces unités multiplient les chances de rétablissement.
Pour lire la suite è Prise en charge des AVC : la France ne tire pas pleinement parti des progrès médicaux | Egora
Ou m’écrire à è [email protected]
Ces UNV “permettent d’assurer la continuité entre diagnostic, traitement et surveillance, renforcement et coordination de l’offre de transports d’urgence, optimisation de la consultation post-AVC, etc.”, loue également la Haute Autorité de santé.
Grâce à ces progrès, la mortalité a diminué de moitié en une vingtaine d’années : 1 patient sur 4 meurt d’un AVC en France, et non plus 1 sur 2.
Une offre de soins spécialisés “inégalement répartie sur le territoire”
Dans les faits, tout le monde ne profite pas de ces avancées, signalent spécialistes, HAS et Cour des comptes, à l’occasion de la Journée de lutte contre les AVC.
“Les résultats obtenus, en premier lieu en termes de taux d’hospitalisation des patients en UNV, mais aussi, dans une moindre mesure, de délais de prise en charge et d’accès aux traitements de revascularisation, ou de qualité des soins, demeurent en effet nettement en deçà des attentes, ou des objectifs visés, malgré les importants progrès accomplis”, relève la Cour.
“Le taux des séjours de patients pour AVC incluant un passage en UNV (soins intensifs et/ou soins non intensifs) ne dépasse ainsi pas 50 %, tous types d’AVC confondus, selon les données de séjours hospitaliers pour 2023, loin de l’objectif visé d’une prise en charge systématique en UNV de 90 % des victimes d’AVC”, indiquent les Sages, constatant une offre de soins spécialisés qui reste “inégalement répartie sur le territoire”.
“Malgré l’atteinte de l’objectif quantitatif de 140 UNV fixé dans le plan AVC, elle ne répond plus à l’ensemble des besoins aujourd’hui identifiés par les ARS.”
Ces unités font par ailleurs face à “des difficultés importantes” de recrutement médical et paramédical, se traduisant par “des tensions sur leurs capacités d’accueil des patients” : fermetures de lits, “récusation de patients”, “incapacité à assurer la permanence des soins 24h/24…
En outre, la couverture du territoire en centres de neuroradiologie interventionnelle, majoritairement adossés aux UNV de recours, “est encore plus inégale”, et ce “malgré l’ouverture récente de nouveaux centres consacrés à la seule activité de thrombectomie”.
20 000 victimes d’AVC sans médecin traitant
Ce n’est pas mieux en phase post-aiguë de l’AVC.
“L’analyse des parcours de soins des victimes d’un premier AVC en 2022 réalisée par la Cour des comptes montre que les réponses aux demandes d’admission en SMR en provenance des services de soins aigus ne sont pas satisfaisantes : les situations les plus sévères font plus souvent l’objet de refus ou connaissent des délais de réponse élevés”, lit-on dans le rapport des Sages.
Et de signaler qu’un tiers des victimes d’AVC ischémiques et hémorragiques présentant des handicaps lourds n’ont pas accès à des soins en SMR.
Le retour à domicile souffre, par ailleurs, de “la difficulté pour les victimes d’AVC d’accéder aux professionnels de santé libéraux nécessaires à leur accompagnement”.
“Si les moyens infirmiers restent assez accessibles, dans des délais réduits, il n’en est pas de même pour les médecins, généralistes et spécialistes, et les rééducateurs.
De plus, la faible coordination entre ces professionnels réduit l’efficacité de la prise en charge des patients”, observe la Cour des comptes.
L’hospitalisation à domicile (HAD) de rééducation demeure, elle, “encore trop marginale”, regrette la Cour, qui défend “une approche décloisonnée hôpital-ville-médico-social pour progresser”.
En médecine de ville, “près de 7 000 victimes d’AVC en 2022 n’avaient toujours pas consulté de médecin généraliste, de cardiologue ou de neurologue en ville en juin 2024”, note la Cour.
Et d’ajouter qu’en 2022, “près de 20 000 victimes d’AVC bénéficiant d’une affection de longue durée (ALD) n’avaient pas de médecin traitant”, ce qui “ne contribue pas à aider les patients à changer leurs habitudes de vie après un AVC pour en prévenir la récidive, ni à améliorer l’observance de leurs traitements”, déplore l’instance.
Le rôle “essentiel” du médecin traitant”
Alors que “les prévisions épidémiologiques font état d’une progression de 35 % des AVC en 2035”, “à pratiques constantes”, la Cour des comptes plaide pour une prévention primaire renforcée.
“La survenance des AVC pourrait être largement évitée par une meilleure connaissance des facteurs de risque”, insiste-t-elle.
Or, pour l’heure, “la spécificité de la hiérarchie des facteurs de risque de l’AVC n’est pas suffisamment prise en compte”.
La lutte contre l’hypertension notamment, “qui représente le facteur de risque principal de l’AVC”, “devrait davantage constituer une priorité de la politique de prévention”.
“La prévention de l’AVC apparaît aussi insuffisamment orientée sur le dépistage et le suivi des populations particulièrement exposées au risque d’AVC” (personnes ayant des comorbidités, patients de plus de 60 ans…), poursuivent les Sages, pour qui le rôle du médecin traitant dans le repérage de ces publics à risque, leur suivi et leur orientation dans des parcours de soins adaptés apparaît “essentiel”.
Or, à ce jour, le suivi des personnes à risque par le médecin traitant apparaît “insuffisant”.
Problème : “La médecine de ville ne dispose pas, en France, d’un ensemble de référentiels portant sur les actes ou examens de prévention à proposer tout au long de la vie, comme cela peut être le cas dans de nombreux pays”, indiquent les Sages de la rue Cambon.
La recommandation de la HAS sur le risque cardiovasculaire global en prévention primaire et secondaire “tarde à être publiée”.
En outre, les médecins généralistes restent “peu incités” par l’Assurance maladie à “consacrer plus de temps et d’attention, dans leur pratique, à la prévention primaire des maladies cardio-neurovasculaires”, juge la Cour.
“La majoration de prévention appliquée au forfait médecin traitant, versée par patient, qui se substituera à la Rosp à compter de 2026 aux termes de la nouvelle convention médicale signée en 2024, est assise sur 15 indicateurs dont trois seulement concernent directement les facteurs de risque cardiovasculaires”.
Références : Avec AFP et Prévention et prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (Cour des comptes)
Auteur de l’article Louise Claereboudt – Cheffe de rubrique Rencontres